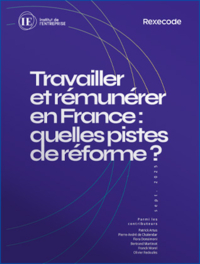Focus
Perspectives économiques à court terme
L’Institut de l’Entreprise publie avec Rexecode les conclusions du groupe de travail "Rémunérer, Travailler" qu'ils ont animé dans le cadre du Front Économique porté par le Medef. Alors que le débat public se concentre sur la question du partage de la croissance, ce rapport recentre la réflexion sur les fondements économiques de la prospérité collective: la productivité et le financement durable de notre modèle social. 7 propositions sont avancées.
Dans le cadre de l’initiative du Front Économique portée par le Medef, l’Institut de l’Entreprise publie en partenariat avec Rexecode, les conclusions du groupe de travail "Rémunérer, Travailler", comprenant les contributions de Pierre-André de Chalendar, Patrick Artus, Flora Donsimoni, Bertrand Martinot, Franck Morel et Olivier Redoulès.
Alors que le débat public se concentre principalement sur la question du partage de la croissance, ce rapport entend recentrer la réflexion sur les fondements économiques de la prospérité collective : la productivité et le financement durable de notre modèle social.
Ce travail collectif débouche sur sept propositions structurantes qui visent à renforcer durablement la capacité productive de l’économie française. Elles s’articulent autour de quatre dimensions interdépendantes :
o La relation entre quantité de travail et productivité ;
o Le coût du travail et son impact sur l’emploi ;
o Les mécanismes de partage de la valeur ajoutée ;
o Les réformes nécessaires du système de retraite.
Le modèle social français, largement financé par les prélèvements sur le salaire, est fragilisé par deux dynamiques structurelles : le vieillissement démographique et l’érosion de la base salariale. Dans ce contexte, le rapport propose de repenser les mécanismes de solidarité pour renforcer la soutenabilité du système, tout en favorisant l’emploi et la compétitivité (propositions 1, 3 et 4).
Le groupe de travail s’est ainsi concentré sur une première piste: alléger le coût du travail (proposition 1). Le rapport recommande en effet un transfert progressif de 30 à 50 milliards d’euros de charges employeurs (notamment les cotisations famille et maladie) principalement vers la TVA, afin de réduire le coût du travail, en particulier pour les salaires intermédiaires et supérieurs. Cette bascule, menée de façon synchronisée, serait accompagnée de négociations salariales pour préserver le pouvoir d’achat, d’ajustements ciblés pour atténuer les effets anti-redistributifs et d’une possible désindexation temporaire du SMIC et des prestations sociales. Selon les simulations du modèle Mésange (DG Trésor), cette réforme pourrait générer environ 200.000 emplois nets en cinq ans.
En second levier, les contributeurs proposent de réduire les dépenses actuelles du système de retraite (proposition 3). Alors que les retraites pèsent près de 14% dans le PIB en 2023, elles constituent un quart des dépenses publiques. Pour amoindrir cette charge, plusieurs mesures sont envisagées : allonger la période de référence pour le calcul des pensions, recentrer certains dispositifs de solidarité, réformer l’indexation des pensions, ainsi que rapprocher progressivement la fiscalité des retraités de celle des actifs. Ces ajustements visent à contenir les dépenses sans remettre en cause l’équité du système.
Le rapport s’oriente ensuite vers une suggestion qui vise à diversifier le financement par une dose de capitalisation (proposition 4). Pour compenser l’érosion du rendement du système par répartition, ce dernier propose d’introduire une composante de capitalisation en élargissant les dispositifs d’épargne retraite existants avec des incitations renforcées, et en créant un fonds collectif de capitalisation vers lequel une part des cotisations pourrait être redirigée. Ce fonds, géré de façon prudente, permettrait de mieux valoriser l’épargne des actifs en tirant parti de la croissance mondiale, tout en améliorant la soutenabilité du système à long terme.
En complément de cette réforme structurelle du financement des retraites, il apparaît indispensable d’agir sur la quantité de travail disponible dans l’économie. Cela implique de valoriser et d’allonger la durée de l’activité professionnelle, en agissant à la fois sur l’emploi des seniors et des jeunes ; et sur la durée effective du travail.
Dans un contexte marqué par un déficit de l’activité des seniors, la persistance d’un temps partiel subi et les déséquilibres budgétaires des régimes sociaux, l’augmentation du temps de travail mobilisé dans l’économie constituent un levier incontournable pour soutenir la croissance et financer durablement notre modèle social. Le rapport identifie deux axes d’action prioritaires: l’allongement de la durée des carrières et l’élévation du temps de travail effectif, afin de renforcer la participation active à la production nationale (propositions 2 et 5).
La seconde proposition du groupe de travail vise à prolonger l’activité en fin de carrière (proposition 2). En effet, le taux d’emploi des 60-64 ans en France reste inférieur à la moyenne européenne, limitant la richesse produite et pesant sur les régimes de retraite. Pour y remédier, plusieurs ajustements sont proposés : ne pas revenir sur l’âge légal de départ à la retraite fixé à 64 ans, tout en encourageant les départs plus tardifs via des mécanismes d’incitation ou de décote ; encadrer les usages de la retraite progressive et du chômage comme préretraite, mieux cibler les dispositifs de carrières longues et de pénibilité, en renforçant la prise en compte des durées réellement cotisées ; réformer les règles de certains régimes complémentaires, à l’image de l’Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du commerce, et de l’industrie et des services.
En cinquième suggestion le rapport recommande d’augmenter la durée effective du travail (proposition 5). La France se distingue par une durée annuelle du travail inférieure à la moyenne européenne pour les salariés à temps complet. Pour lever les freins existants, il est notamment proposé de renforcer la souplesse dans la gestion du temps de travail, en permettant aux entreprises de négocier les seuils de déclenchement des heures supplémentaires, simplifier le recours aux heures supplémentaires, notamment par la suppression du contingent annuel et des contraintes associées, et inciter les salariés modestes à travailler plus d'heures, en excluant les heures supplémentaires du calcul de la prime d’activité.
Ces mesures visent à restaurer une dynamique de progression de carrière, à mieux rémunérer l’effort et à renforcer la participation de chacun à la production collective.
Au-delà du volume de travail, le rapport appelle à mieux associer les salariés à la performance économique, dans un contexte de stagnation perçue du pouvoir d’achat.
Dans un contexte de tensions autour des inégalités de revenus et de patrimoine, le rapport propose d’encourager une meilleure participation des salariés à la performance économique, à travers des outils de partage de la valeur plus largement diffusés (propositions 6 et 7).
La sixième proposition s’articule ainsi autour d’un même objectif: renforcer l’épargne salariale et l’actionnariat salarié. Cette dernière vise à amplifier l’usage des dispositifs de partage de la valeur : intéressement, participation, et actionnariat salarié, afin de mieux diffuser les gains de productivité et de stimuler l’épargne longue. Les mesures recommandées incluent de flécher une part significative (au moins 50 %) des dispositifs d’épargne salariale vers des supports investis en actions, notamment dans le cadre de la retraite, réduire la fiscalité sur l’abondement volontaire et faciliter l’investissement en actions de l’entreprise, allonger la durée de blocage des plans d’épargne pour favoriser l’investissement à long terme, ainsi que mettre en place une allocation par défaut inspirée du modèle américain 401(k) pour encourager l’actionnariat salarié. Ces mesures contribueraient à réduire les inégalités patrimoniales et à renforcer l’implication des salariés dans la stratégie économique des entreprises.
Enfin, la dernière proposition et septième proposition vise à introduire des mécanismes de performance dans la fonction publique. Afin de stimuler la transformation de l’administration publique, le rapport propose la création d’un fonds de redistribution destiné aux agents de l’État, alimenté par une fraction des économies réalisées au sein de chaque entité. Ce dispositif reposerait sur des primes d’intéressement négociées localement, la définition d’objectifs endogènes et mesurables au sein des services concernés, et une modification du cadre réglementaire pour intégrer cette logique incitative dans la fonction publique. Ce mécanisme permettrait de mieux aligner incitations individuelles et performance collective, tout en favorisant une appropriation des réformes par les agents eux-mêmes.
À travers ces sept propositions, ce rapport entend contribuer de manière concrète et argumentée au débat sur l’avenir du modèle économique et social français. Son objectif est clair : soutenir durablement la production et l’emploi, tout en assurant le financement de la protection sociale dans un cadre plus juste et plus efficace.
Sa philosophie d’ensemble repose sur une conviction forte: redonner toute sa place au travail dans notre pacte social, en valorisant l’effort, en récompensant l’engagement et en réconciliant performance économique et équité.
Annoncé lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (La REF24) par Patrick Martin, Président du Medef, le Front économique a été officiellement lancé le 24 octobre 2024 à la Cité de l’économie dans l'objectif notamment d'apporter de la rationalité économique au débat public.
Les groupes de travail co-présidés par un économiste et un chef d'entreprise avec l’appui d’un think-tank, se sont réunis régulièrement durant plusieurs mois pour formuler des diagnostics et des propositions sur des sujets clés tels que la productivité, l'emploi, et la compétitivité.
Les travaux du front économique ont donné lieu à la publication d'une tribune collective dans Le Grand continent le 29 août 2025, co-signée par Philippe Aghion, Patrick Martin et une soixantaine d'économistes et acteurs du monde l'entreprise, dont Denis Ferrand, Olivier Redoulès, Charles-Henri Colombier, Raphaël Trotignon et Anthony Morlet-Lavidalie de Rexecode.
Le Nouveau Consensus européen et le contretemps français
Le Grand continent, 29 août 2025
Après plusieurs mois de travail, une centaine d'experts, d’universitaires et de dirigeants d’entreprise proposent une pièce de doctrine pour provoquer un sursaut. Les 35 recommandations du Front économique pour en finir avec "le contretemps français".